Dans le parler lyonnais, on les appelait les affaneurs, des ouvriers mais en version champêtre. Ils formaient avant la Révolution la moitié de la population active. Situés en bas de l’échelle sociale, ils n’en étaient pas moins indispensables à leurs contemporains.

Léon Lhermitte, 1882, “La paye des moissonneurs”
Il a arqué toute la journée. En ce matin de juillet, vers l’an 1640, Claude Monod s’est rendu sur le champ de blé de son employeur dès les premières lueurs de l’aube, pour moissonner les épis ployés par les grains mûrs. Il faut agir sans tarder, car la moindre pluie pourrait jeter les récoltes à terre. Et sans elles, point de pain, point de vie, la famine pointera son museau hideux dans les maisons de Vénissieux. Une troupe de moissonneurs se déploie à travers champs, tous armés d’une grande faucille, avec laquelle ils scient les poignées de blé prises à pleine main, le corps cassé en deux, tandis qu’en arrière les femmes ramassent les tiges coupées, forment les gerbes et les rassemblent en tas réguliers. Tous se dépêchent, conscients de l’enjeu vital du travail. À ce rythme, la fatigue vient vite. Mais bientôt l’on fêtera les greniers de nouveaux pleins, voilà qui met du cœur à l’ouvrage.
Puis vient le début de la nuit. Claude Monod retourne chez lui, après avoir trimé pendant 15 à 17 heures d’affilée. Sur le chemin, il rejoint des files de travailleurs agricoles semblables à lui, qui portent sur leurs épaules les céréales versées par leurs patrons en guise de salaire : une gerbe pour vingt moissonnées, c’est le tarif. Ils avancent dans la nuit tombante comme un cortège de fantômes, d’un pas rendu lent par la besogne effectuée. Le nom de ces forçats ? Des “affaneurs”. Un mot franco-provençal, la langue parlée autrefois dans la région lyonnaise, qui désigne les ouvriers des champs embauchés à la journée.
Ces journaliers sont légion dans le Vénissieux d’Ancien Régime, au point de constituer plus de la moitié des chefs de famille. On fait appel à leurs services deux-trois jours à l’avance, avec en guise de contrat une simple parole donnée, ou bien un coup à boire à l’auberge pour sceller l’accord entre patron et salarié. Tous les travaux pénibles de la campagne leur sont confiés. Faucher les foins, moissonner, vendanger, battre les épis pour en tirer le grain, creuser les fossés, tailler les haies bordant les champs, couper le bois pour la cheminée, labourer les terres à la houe lorsque le patron n’a pas les moyens de s’offrir une charrue. Le tout pour un salaire de misère.
En 220 jours de travail, calcule le marquis de Vauban, Claude Monod et ses compères ne gagnent que 110 livres par an. Une misère, deux à trois fois moins qu’un artisan de village, et une goutte d’eau par rapport à l’océan d’écus que ramènent les bourgeois. Sur cette somme, il faut défalquer les impôts à payer et la nourriture à acheter. Au bout du compte, il ne reste à l’affaneur qu’une quinzaine de livres par an, “sur quoi il faut que ce manœuvrier paye le louage ou les réparations de sa maison, l’achat de quelques meubles, quelques écuelles de terre, des habits et du linge, et qu’il fournisse à tous les besoins de sa famille pendant une année”. Une vie entière à fleur de pauvreté attend ces malheureux. L’hiver, pour eux, s’avère particulièrement difficile à traverser. Au village, le travail des champs s’arrête et, avec lui, les possibilités d’embauche. Au rythme infernal de l’été succède le fléau du chômage, la bourse vide, le pain chichement compté, la main tendue vers la charité des mieux dotés.
Emprunter ? Les affaneurs l’envisagent comme une dernière extrémité, car les prêteurs ne leur feront aucun cadeau, et prendront en guise de garantie, une hypothèque sur la petite maison, les deux-trois moutons et les quelques arpents de terre que possèdent la plupart des ouvriers vénissians. Sans doute appauvri par plusieurs années de blé trop cher pour sa bourse, notre Claude Monod se décide à emprunter les sommes nécessaires pour joindre les deux bouts de l’an. Mal lui en prend. Le piège de l’endettement se referme sur lui, et aggrave sa situation en un rien de temps. À tel point que le 5 mars 1646, il est contraint de vendre à un maréchal-ferrant du village le peu qu’il lui reste de biens : une vigne, deux tonneaux et surtout sa maison, le tout pour 190 livres dont 10 payées le jour même, “que ledit vendeur a déclaré estre pour soy achepter des habicts don il a extremement besoing”… À lire les vieux registres notariés de Vénissieux, son cas est loin d’être isolé. Déjà en 1593, Antoinette Bouchard, veuve de l’affaneur Jean Rosset, avait aussi été forcée de vendre sa maison pour une bouchée de pain.
Au moindre accident de la vie, une guerre, une famine, une longue maladie, trop d’enfants à nourrir, ces prolétaires d’Ancien Régime se trouvent réduits à la mendicité, à l’errance, à l’enfer. Comme Marie Chenavier. Originaire de La Tour-du-Pin, elle se voit réduite à quitter son mari journalier, “attendu son peu de fortune”, et erre pendant deux ou trois ans sur les routes du Bas-Dauphiné. Son vagabondage l’amène en 1775 à Vénissieux, où les mauvaises langues se liguent contre elle : “on débitoit dans le public faussement et surtout dans celuy de Vénissieu, quelle est enceinte des faits de Jean Blajot fils de Pierre, maréchal de Vénissieu”. Les pierres pleuvent sur la miséreuse, contrainte de déclarer que “c’est faux, qu’elle n’est pas enceinte et n’a eu aucun commerce” avec le fils du forgeron. Marie Chenavier touche le fond du fond. On comprend qu’à ce régime, les affaneurs soient les premiers à se révolter lorsque le peuple gronde. Mais malheur à eux s’ils sont pris. Pour un bout de pain volé en période de disette, leur corps se balancera au bout de la potence… Pourtant, tout n’est pas noir pour les ouvriers de la terre. Ceux qui ajoutent à leurs salaires les revenus d’un artisanat ou d’un petit commerce, trouvent une planche de salut capable de les sortir de l’ornière. La preuve ? Ils ont aujourd’hui en France, des dizaines de millions de descendants.
Sources : Archives du Rhône, 3 E 11442 à 11495. Vauban, Projet d’une dixme royale, 1707.
















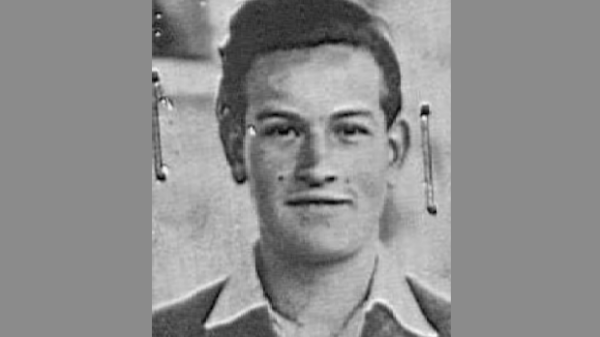




















Alain RÉMI
14 janvier 2021 à 11 h 52 min
Bonjour! Ce magnifique tableau de Léon Lhermitte transpire la résignation pour ne pas dire le désespoir. Je comprends que les nantis préfèrent montrer l”Angélus” de Léon que ce tableau qui a lui seul pourrait déclancher une révolte si ce n’est une révolution. Vous remarquerez qu’il porte des sabots ce qui signifie qu’il doit avoir ses pieds en piteux états… Vraiment, regarder ce chef d’oeuvre un peu trop longtemps me donne envie de couper des têtes…