

Associées à trois artistes invités (Maxime Delhomme, Émilie Saccoccio et Margot Da Fonseca), six étudiantes ont été retenues pour la première résidence artistique des récupérathèques (RARe) à se tenir au centre d’art Madeleine-Lambert. La première et, espère la commissaire d’exposition Esther Coillet-Matillon, pas la dernière.
Celle-ci et les trois artistes animaient, le 16 avril dernier, une table ronde pour expliquer leur démarche, qu’Esther définissait comme “l’aboutissement et le lancement de quelque chose”. L’enjeu étant de transformer le centre d’art vénissian en “lieu d’expérimentation” où vont se retrouver jusqu’à la fin de la semaine les artistes, les étudiantes résidentes (Clémence Estingoy, Carla Bonavant, Amandine Rigaud, Angèle Guilly, Éléonore Ferret et Éva Habasque), les adhérents des ateliers Henri-Matisse et les Vénissians désireux de participer à des démarches artistiques originales et innovantes. Et, également, une association, Espoir du Soudan.
Comment repenser le processus créatif d’une manière éco-responsable ? Cette question, les artistes se la sont déjà posée — il n’est qu’à voir leurs parcours respectifs — et la remettent à nouveau en jeu toute la semaine. “Vénissieux, remarquait Esther, est la ville de la toile cirée, qu’il est pourtant compliqué de trouver aujourd’hui.” Au cœur des récupérathèques, constate-t-elle encore, se trouve “la transmission des savoir-faire pour prendre soin des ressources et mieux les utiliser”.
Des parcours d’expérimentation
Ancienne élève des Beaux-Arts de Lyon, Margot Da Fonseca habite aujourd’hui à Bruxelles et fait partie du collectif Cycl.one qui prône “l’urbanisme transitoire, c’est-à-dire l’occupation temporaire de bâtiments vides, avec pour but d’avoir un impact sur la ville à long terme”. Pour elle, “le textile est un langage en soi”. Elle raconte son expérience dans la coopérative textile Sasakuy du nord de l’Argentine, où elle a appris les techniques locales pour tisser un awayo, couverture andine. Après ce stage, Margot a utilisé les lieux (colonnes, cours…) comme métiers à tisser. Elle parle aussi de la souplothèque qui, en Belgique, récupère les matériaux souples.


Émilie Saccoccio travaille pour sa part la photo, la vidéo et l’écriture. Un séjour au Mexique la familiarise avec la fête des morts, un thème au cœur de sa création. Elle en tire un court-métrage documentaire, Le Visage et la Marque, et s’appuie sur le concept de solastalgie, inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht : “forme de souffrance et de détresse psychique ou existentielle causée par les changements environnementaux passés, actuels et attendus, en particulier concernant le réchauffement climatique et la biodiversité”.
Pour les ateliers, elle s’avoue “séduite” et évoque “le besoin d’un retour au collectif”, avec “une ouverture à l’intervention de l’autre”.
“J’ai beaucoup lu sur la ville de Vénissieux et son passé industriel. Les rencontres que j’ai faites vont me permettre de faire des propositions artistiques, en faisant le lien entre la toile cirée, le support, l’écran, la couverture, le vêtement, le refuge.”
Une exposition visible jusqu’au 30 avril
Maxime Delhomme a lui aussi fait des études à Lyon avant de partir en Turquie via Erasmus. Il se revendique “issu d’une famille prolétaire” et raconte : “J’ai découvert l’art à 20 ans, il a changé ma vie. Je veux à présent fusionner l’art et la vie à travers trois pôles : le dessin, la peinture et la performance.”
Il dit encore : “Je ne mets aucune barrière pour réaliser des projets irréalisables” et sait bien que “l’art est un espace de liberté et d’autorité, avec un artiste qui impose sa vision”.
S’il reconnaît une certaine démocratisation de l’art — “l’artiste s’adapte en permanence aux spectateurs, aux participants” —, il avance une critique de cette pratique : “On réduit les artistes à des pédagogues. Je veux bousculer la hiérarchie des structures dans lesquelles j’interviens.”
Quant à sa participation à la RARe, il va droit au but : “J’aimerais travailler sur ces sujets de domestication de l’artiste avec le groupe. Et réfléchir à notre propre statut, notre propre condition.”
Le vendredi 22 avril, à 18 heures, on pourra voir au centre Madeleine-Lambert le résultat de cette première résidence artistique des récupérathèques. L’exposition sera visible jusqu’au 30 avril, du mercredi au samedi de 14h-18h et sur RDV.









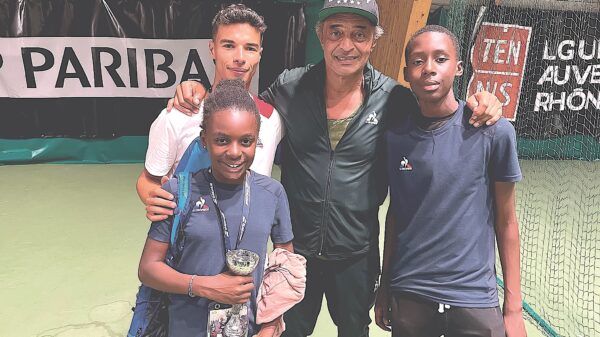


























Derniers commentaires